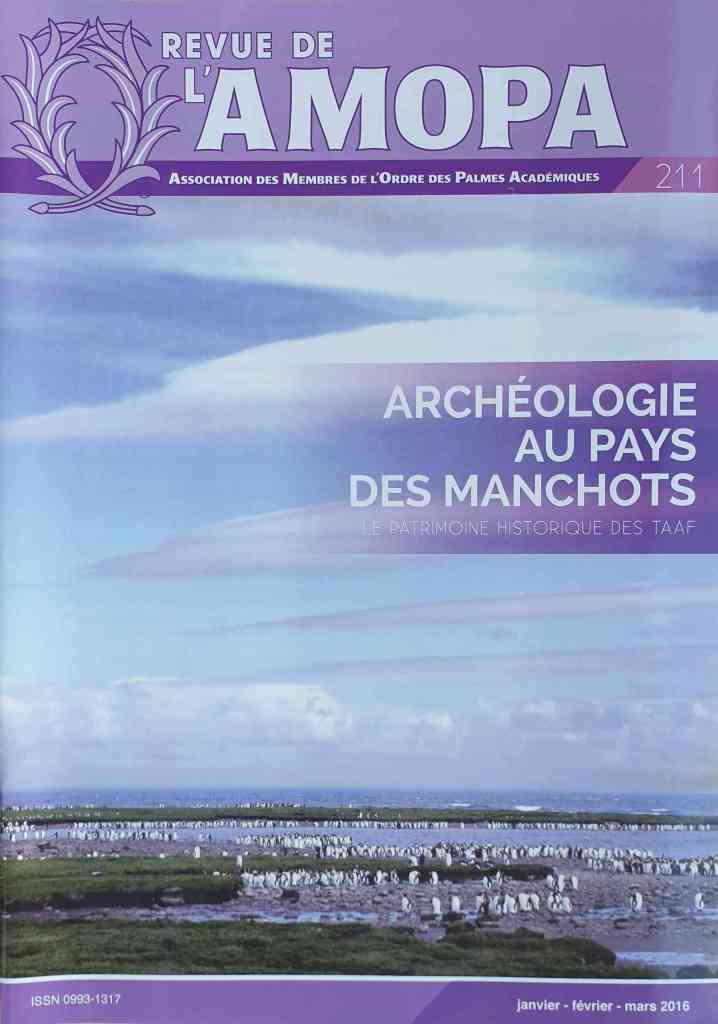Le patrimoine historique des Terres Australes et Antarctiques Françaises
Conférence donnée par Monsieur Jean-François Le Mouël, Membre de l’Académie des Sciences d’OUTRE-MER à l’occasion de l’Assemblée générale de la section Paris XIIIe, à l’Ecole Nationale de Physique-Chimie-Biologie
Cette conférence a été publiée dans la revue de l’AMOPA N°211 en mars 2018
L’Archéologie au pays des manchots !
Le patrimoine historique des TAAF
[Terres Australes et Antarctiques Françaises]
Né au XVIème s. en Berry où ma famille, comme tant d’autres et selon la plaisante formule de mon Maître Leroi-Gourhan, résidait depuis le néolithique, je m’interroge souvent sur les raisons qui me poussèrent à m’en arracher… Ce qui orienta ma vie de chercheur fut incontestablement cette phrase que mon professeur de Lettres du Lycée, au milieu de tant d’autres citations de Sénèque à Valéry, avait fait inscrire sur les murs de notre classe de 1ère : « Seuls verront loin les passionnés[1] ». Il s’y mêlait cette autre maxime de Cocteau « A l’impossible je suis tenu [2]» ! Et en écho lui répondait enfin la devise de Jacques Cœur gravée en maints endroits de son palais « A vaillant cœur rien d’impossible ». Erudite locale, ma grand-mère l’avait plutôt déchiffrée en « A vaillant cœur, riens impossibles » qui, à ses yeux condamnait tout un chacun à bannir la médiocrité ! Dans l’exaltation de mon adolescence, je quittais Bourges ! Pour qu’elle y trouvât sa mesure, je devais vaincre toutes mes frilosités… Je partirai donc pour l’Arctique, à la découverte de ceux qui y vivaient, les Eskimos[3] !
Comprendre l’Autre dans sa culture était un autre leitmotiv : je serai ethnologue. Or, l’ethnologie demandait la durée sur le « terrain ». Je passais en missions cumulées près de 10 ans au Groenland, quelquefois lors de missions de 2 années consécutives. Suivirent des missions dans l’Arctique occidental canadien une région que gagna le front pionnier américano-européen après le second choc pétrolier. Aux pétroliers en quête de nouveaux gisements, les Inuit du lieu s’étaient alors mis à vendre « sous l’anorak » les vestiges de leur passé : statuettes, têtes de harpons en ivoire, etc.
Conscient que les Inuit bradaient leur âme, je décidais de me tourner vers l’ethnologie du passé, l’archéologie. Non seulement je sauverai ainsi les vestiges mais en intégrant de jeunes inuit à mes équipes, nous les « conscientiserions » à la valeur de leur passé, leur donnant ainsi un « squelette » pour construire leur avenir. Dans le même temps, la MIAFAR – Mission Archéologique Française de l’Arctique – que je créais diffuserait en Amérique du Nord les méthodes françaises de fouilles fines !
Encore fallait-il adapter celles-ci aux conditions extrêmes du milieu polaire ! La montée en puissance des ordinateurs – le premier sur le terrain dès 1984 – puis l’utilisation du théodolite à laser, les compétences des spécialistes du CNRS enfin nous y aidèrent. Désormais libérés des contraintes du papier millimétré dont nous étions jusqu’alors tributaires pour l’enregistrement des observations, nous pouvions fouiller dans le vent, la pluie et la neige !
La chance – celle qui n’arrive peut-être qu’une fois dans la vie d’un archéologue – fut la découverte de la première peinture de la préhistoire des Inuit. Sur un disque vertébral de baleine (ø 22cm) une représentation – très dynamique – d’un chasseur courant en brandissant son arc.
En quelques heures l’annonce de la découverte fit le tour du monde. A la suite d’une communication à l’Académie des Sciences, les journaux lui consacrèrent leurs meilleures feuilles ! Lors d’une rencontre fortuite avec l’Administrateur supérieur des TAAF celui-ci m’interrogea : « Se pourrait-il que les TAAF puissent recéler un patrimoine historique ? Si personne ne s’y installât jamais – à quelques brèves exceptions près – des centaines de gens y passèrent, sans doute laissèrent-ils des vestiges ? Vous devriez y aller et me faire un rapport ! »
J’acceptai le défi… et le grand écart, et je passai de l’Arctique à l’Antarctique, dans notre France du bout du monde ! L’Arctique m’avait préparé à l’Antarctique…
Dès la première mission (1993) les 200 pages du premier rapport sur le Patrimoine historique des TAAF en affirmèrent non seulement l’existence mais encore la richesse… Les 16 missions qui suivirent s’ingénièrent à le révéler, le mettre en valeur et parfois le restaurer. C’est l’aventure de ceux qui fréquentèrent ces îles au long des 200 dernières années que je voudrais vous conter maintenant à partir de quelques-uns des vestiges matériels laissés sur le terrain, parfois de leurs écrits.
J’évoquerai d’abord les figures des Kerguelen, Crozet, Dufresne, Dumont-d’Urville et de leurs équipages qui, à partir de 1772 et jusqu’au milieu du XIXème s., révélèrent ces terres australes. Bravant les « 40èmes rugissants et les 50èmes hurlants » ils en prirent possession « Au nom du roi » ou « Au nom de la France ». Les vieilles rivalités entre la France et l’Angleterre se jouèrent là aussi, une fois n’est pas coutume, en faveur de la France. Cook supplanté de quelques mois par Kerguelen en 1772, reconnut à ce dernier la priorité de la découverte et, magnanime, décida de donner à ces îles le nom de leur découvreur leur évitant celui d’Ile de la Désolation qu’il leur avait donné dans un premier temps !
C’est pourtant ainsi qu’elles furent nommées pendant les décennies qui suivirent par les baleiniers. Ils arrivèrent dès la fin du XVIIIème s. dans les parages des îles australes (Kerguelen, Crozet) pour y chasser principalement la Baleine à Bosse (Megaeptera novaeangliae), la Baleine des Basques (Eubalaena glacialis) et le Cachalot (Physeter macrocephalus). Ce dernier surtout était prisé tant une huile contenue dans sa boîte crânienne était réputée pour sa finesse : elle servait dans les industries horlogère et textile. Quant aux huiles des autres cétacés, on les obtenait en faisant fondre leur lard dans de grandes marmites en fonte sur des fours de pierre – pour les plus anciens, puis de briques apportées par les baleiniers eux-mêmes de leurs pays respectifs. Ces dispositifs parsèment encore les plages et constituent des vestiges massifs d’une période qui se prolongea jusqu’au début du XXème s. Et précisément les marques laissées sur les briques des fours ou sur les chaudrons eux-mêmes trahissent les origines de ces hardis baleiniers anglais du sud de l’île et surtout américains de la côte est des E.U. L’huile obtenue servit d’abord à l’éclairage des grandes villes de cette côte orientale : Boston, Philadelphie, Providence, etc. toutes proches des ports baleiniers de la région : Nantucket, Mystic, Salem, etc.
En fait l’utilisation de cette huile aux propriétés extraordinaires dont la conservation des qualités aux très hautes températures se poursuivit tardivement jusqu’à l’invention des huiles de synthèse. Lors de la guerre de Corée, elle lubrifiait encore les moteurs des avions à hélice…
Ces populations baleinières laissèrent entre autres vestiges des sites de naufragés et des cimetières.
Sites de naufragés composés d’un ou deux fonds de cabanes que les occupants, dans les conditions rudimentaires que l’on devine et que trahissent les pauvres vestiges abandonnés sur les côtes de Kerguelen (surtout) : couteaux, bottes de cuir d’éléphants de mer infiniment rapiécées, fragments de pipes en terre, etc. Parfois la gravure d’un nom de bateau et le nom du naufragé sur une pierre proche du campement « d’infortune de mer ». Les archéologues purent ainsi relever et déchiffrer plus de 120 pétroglyphes, principalement sur les îles de St Paul et d’Amsterdam…
Çà et là sur les côtes, les archéologues ont révélé la présence de tombes isolées, mais c’est seulement en 2 points des Kerguelen qu’elles sont regroupées en « cimetières ». L’un, le plus ancien, sur la côte orientale fut abandonné vers 1854 quand fut découverte l’île de Heard – aujourd’hui australienne, à environ 400 miles au sud de Kerguelen – et ses eaux plus riches en cétacés. Alors les baleiniers fréquentèrent le sud des Kerguelen plus proches et y firent mémoire de leurs disparus – tombes et cénotaphes – sur « l’Ile du cimetière ». Là, les archéologues n’eurent qu’à enregistrer les stèles en bois sur lesquelles ont parfois résisté un nom et une parole pieuse tirée de la Bible…
Les baleiniers avaient ouvert la voie et saison après saison de chasse tracèrent de nouvelles cartes ; l’Amirauté britannique sut en tirer profit. En 1874, le Challenger qui depuis 1872 parcourait le monde et collectait les données scientifiques que l’on sait passa par les Kerguelen. La communauté scientifique d’alors se préparait à observer le Passage de Vénus (passage de Vénus devant le soleil), phénomène récurrent à cycle séculaire et qui devait se produire le 9 décembre 1874. Les astronomes avait calculé qu’il serait particulièrement visible dans l’hémisphère sud ; aussi, les instances scientifiques anglaises déroutèrent-elles le Challenger pour qu’il leur rapportât l’endroit le plus propice à l’établissement de leur observatoire. Une sorte de « Yalta scientifique» avait déjà eu lieu : Américains, Anglais et Allemands établiraient leurs bases aux Kerguelen, les Français à l’île St Paul et… en Nlle Calédonie !
120 ans après, les archéologues repérèrent donc les sites d’édification des différents observatoires astronomiques et inventorièrent les quelques éléments de construction ou mobiliers qui y avaient été abandonnés… En fait, pas grand-chose sinon dans la Baie de l’Observatoire (Kerguelen) et à St Paul.
Abandonnés par les Anglais dès la fin décembre 1874, les bâtiments furent réutilisés par une mission allemande en 1903-1904 ; celle-ci, en route pour l’Antarctique y laissa 4 scientifiques dont le météorologue alpiniste J. Enzensperger qui y mourut. Une campagne internationale de fouilles archéologiques se déroula en ce lieu en 2006-2007 ; ses résultats ont été consignés en ligne et en temps réels @Archaeobs).
La présence française dans ces îles était trop sporadique pour que, de temps à autre, ces confettis de la France du bout du monde ne soient pas convoité, leur appartenance contestée, notamment par l’Angleterre. En 1844 il fallut réaffirmer celle de l’île St Paul…
Aux Kerguelen, les appropriations françaises remontaient à plus d’un siècle. Aussi, en 1893, le projet de 2 Havrais, les frère Bossière, arriva t-il à point nommé ! A Kerguelen ils se proposaient de faire revivre la chasse aux mammifères marins pourvoyeurs d’huile, l’élevage du mouton et, sur l’ile St Paul, d’exploiter les fabuleux gisements de langoustes…
Utopiques les 3 projets eurent la vie brève : l’élevage du mouton qui suscita une difficile sédentarisation de bergers havrais connut ses morts et, Port Couvreux –leur lieu de résidence au demeurant fort bien installé – dut être abandonné. Plus dramatiques fut l’entreprise de la « Langouste française », non qu’elle ne fût rentable, mais une suite de fortunes contraires des navires ravitailleurs conduisit à un désastre et les marins bretons, isolés sur ce volcan égueulé, connurent une tragédie et plusieurs morts.
Guère plus heureux ne fut le « revival » de la chasse aux baleines dans les eaux de Kerguelen… mais tellement plus riches en vestiges laissés aux archéologues ! Une station baleinière sur 6 ha ! Imaginez le musée Beaubourg, perdu en pleine toundra et dans un état de ruines trop avancé pour qu’on puisse tout restaurer. Mais tellement oublié et fragilisé qu’on se sente immédiatement un devoir de protection et de mise à disposition des générations futures.
Les arguments historiques ne manquaient pas non plus : construite par les Norvégiens selon un modèle « clefs en main » qui connut 7 autres exemplaires, elle est la seule rescapée – même en pitoyable état – et se trouve en France !
Un rapport circonstancié, un préfet cultivé et une administration clairvoyante firent honneur à la France, « mère des arts… et des lois ». Une restauration raisonnée et qui pourrait s’échelonner dans le temps fut commencée en 2000. La première année, on s’acharnerait à sauver l’atelier – un des cœurs de l’usine puisqu’il était le symbole de l’autarcie des courageux marins. Bâtiment d’architecture scandinave, l’atelier est une «ossature bois », recouverte d’un bardage soit en « rainure /languette », soit à clins.
Les charpentiers, compagnons et le menuisier de l’Ecole Boulle, tous bénévoles, s’en donnèrent à cœur joie. Débarrassée des vestiges de ses parements malmenés par le temps qui passe, les vents et l’humidité de Kerguelen, la structure chevillée fut démontée et emportée en pièces détachées à la base de Port aux Français pour être nettoyée, restaurée, remise sur épure… Dans le même temps les archéologues fouillèrent sous l’emprise du bâtiment où ils retrouvèrent nombre d’outils et de pièces mobilières.
Originellement posé à même le sol, les ruines du bâtiment s’étaient inclinées dans le sens de la pente : on coula donc une semelle de béton : elle est cachée par les pierres sèches préalablement numérotées lors du démontage et repositionnées ; elles servent de base à la structure bois reconstruite à l’identique.
Non seulement le bois nécessaire (Pinus) avait été importé de Norvège, mais encore avait on retrouvé dans ce même pays les archives qui permirent de repeindre le bâtiment à l’identique selon le rouge bien connu dans les pays scandinaves…
A un écologiste qui s’était inquiété que l’on donnât cette restauration en exemple puisque « ces bâtiments portaient témoignage d’une période éhontée au cours de laquelle les hommes avaient décimé les baleines »… on répondit que, sans ce témoignage, il n’y aurait plus personne pour en garder mémoire, pas même ses enfants…
Dans les TAAF, la Mémoire s’est mise au service de l’Histoire. Il n’est plus d’Histoire sans archéologie… fût-elle au pays des manchots !
[1] Maurice Barrès
[2] Jean Cocteau
[3] A partir des années 1970, les « Eskimos » canadiens revendiquèrent qu’on leur attribuât l’appellation d’Inuit (sing. Inuk) qu’ils se donnent eux-mêmes.